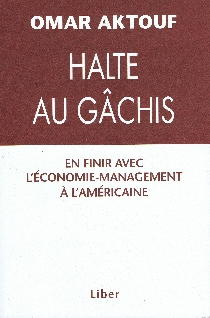Conférence du mardi 13 octobre 2009 - 19 heures
La crise financière mondiale
Comme crise de l'évolution « logique »
du capitalisme hyper financiarisé
Omar Aktouf, HEC-Montréal
Lors d’une allocution présentée chez les Sceptiques du Québec le 13 octobre 2009, Omar Aktouf, professeur titulaire à l’École des hautes études commerciales de Montréal, propose d’examiner les causes profondes de la crise financière mondiale actuelle. Notre vision réductrice de l’économie réelle y aurait contribué pour une large part. Et c’est par son élargissement vers l’humanitarisme que viendront sans doute les solutions durables.
| Omar Aktouf est professeur titulaire à l'École des hautes études commerciales de Montréal et membre fondateur du Groupe Humanisme et gestion. Il est auteur de plus de 100 articles, et de plusieurs livres best-sellers, dont, en particulier, Le management entre tradition et renouvellement, qui en est à sa 4e édition 2006 et La stratégie de l'autruche : post mondialisation, management et rationalité économique, 2002, primé " meilleur livre d'affaires 2003 " et déjà traduit en plusieurs langues, ainsi que son tout dernier, déjà salué par plusieurs médias, dont en Amérique Latine : Halte au gâchis, en finir avec l'économie-management à l'américaine, 2008. |
Lorsqu’Omar Aktouf soutenait, il y a vingt ans, que la mondialisation néolibérale conduirait à la catastrophe, peu de collègues le prenaient au sérieux. Il était compté dans les rangs des altermondialistes alarmistes et utopiques. Pourtant, la crise financière est bien arrivée... et elle était prévisible. De nombreux facteurs économiques l’annonçaient.
Les deux côtés de la monnaie
Revenons aux principes mêmes du libre marché, poursuit le conférencier. L’économie repose sur une monnaie d’échange. Comme l’a vu Aristote, cette dernière a un bon côté et un mauvais côté. D’une part, elle permet les échanges universels : les pièces et les billets remplacent avantageusement les sacs de blé et le bétail donnés, par exemple, en échange d’une propriété convoitée. D’autre part, la monnaie donne l’illusion qu’on peut l’accumuler à l’infini.
Auparavant, personne n’avait pensé pouvoir accumuler blé, bétail et maisons à l’infini, car chacun sait que les ressources physiques sont limitées. Par contre, on peut facilement s’imaginer encaisser des billets sans fin ou voir son compte en banque toujours grossir en y ajoutant un zéro de plus. On pourrait croire qu’on peut s’enrichir personnellement sans limites.
Pourtant, l’étymologie grecque du mot « économie », rappelle Aktouf, signifie « norme pour assurer le bien-être de la communauté ». On constate que cette définition n’a rien à voir avec l’accumulation de richesses personnelles ou la maximisation des profits. L’économie devrait assurer le bien-être personnel à travers celui de la communauté. Pertinemment, la signification du mot « travail » en japonais s’accorde assez bien avec ce principe : « se lever le matin pour rendre son voisin heureux ». À l’opposé, soulignons que l’origine du mot « travail » en français renvoie à la « torture » !
Profit maximal ou optimal ?
Un deuxième facteur a contribué à la crise financière actuelle, soit la recherche du profit « maximal » plutôt que du profit « optimal ». Le concept de profit maximal implique une minimisation des coûts, dont les deux principaux sont le travail et l’environnement. Dans cette optique, on minimise les coûts associés au travail en réduisant la main d’œuvre au minimum et en la payant le moins cher possible – quels qu’en soient les effets néfastes pour la société.
Suivant cette politique sacrée de minimisation des coûts, on ne craindra pas non plus de polluer l’environnement et de reporter indéfiniment la réparation des dégâts causés. Finalement, ce sera encore à la société d’absorber des coûts faramineux de dépollution. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à penser à l’extraction très polluante des sables bitumineux de l’Alberta avec ses lacs d’eau polluée au bitume et ses montagnes de soufre. Et que dire des sociétés minières qui, une fois le minerai ramassé, quittent sans adresse en laissant des trous béants et des terres affreusement contaminées !
Si les entreprises capitalistes visaient un profit « optimal », elles tiendraient compte de tous les coûts de production. Elles incluraient ceux associés au maintien d’une force de travail active et bien formée. Elles ne laisseraient pas aux gouvernements le fardeau de la dépollution. Tous les coûts reliés, de près ou de loin, à la production seraient comptabilisés et payés par ceux qui en profitent : les entreprises et leurs clients.
Chute prévue du capitalisme
L’illusion qu’on peut s’enrichir infiniment par la recherche du profit maximal a conduit aux excès du capitalisme moderne et a précipité sa chute. Il a toutefois survécu grâce à l’aide financière énorme que lui a fournie le gouvernement, son ennemi juré, qu’il a toujours considéré comme beaucoup trop régulateur.
De l’avis du conférencier, le capital porte en lui le germe de sa propre destruction puisqu’il capitalise tous les éléments de production au profit d’un enrichissement privé. Il dénature ainsi la valeur du travail humain et du milieu naturel pour le réduire à une valeur monétaire dont il s’estime propriétaire. Karl Marx l’avait prévu : cet enrichissement débridé ne peut que conduire à la dévalorisation du travail et à son remplacement par la machine automatisée, qu’il a appelée le « travail mort », soit du travail non créatif et sans valeur ajoutée.
Aujourd’hui, la mondialisation des moyens de production se poursuit par fusion, acquisition et délocalisation des entreprises. Nous assistons donc à un phénomène de gigantisme que Marx avait prédit : « Pour les généraux de l’industrie, gagner la guerre du profit ne se fera plus à coup de recrutement, mais à coup de licenciements. » Le capital coupe l’être humain, non seulement des fruits de son labeur, mais également de lui-même, des autres et de la nature, conclut le conférencier.
Efficacité ou rentabilité ?
La progression du capitalisme s’est faite sous couvert d’efficacité, alléguée productive ou financière. Toutefois, il ne faut pas confondre rentabilité et efficacité. « Efficacité » ne signifie pas « faire plus d’argent ». On peut être financièrement rentable tout en étant inefficace et improductif.
Quelle est la vraie définition de ce mot ? En science, efficacité signifie obtenir les mêmes résultats que précédemment, mais en puisant moins dans tous les facteurs qui ont contribué au résultat. En biologie, on peut donner un exemple concret : l’ours est plus efficace aujourd’hui s’il capture autant de poissons qu’hier, tout en blessant moins de poissons et en dérangeant moins l’écosystème.
Appliquons le même principe d’efficacité à l’industrie manufacturière, poursuit Aktouf : General Motors serait plus efficace aujourd’hui qu’hier si aujourd’hui elle produit la même voiture qu’hier avec plus d’employés, plus payés et avec plus d’avantages sociaux, et en polluant moins la nature. Cette définition va à l’encontre de ce qui est généralement accepté. On juge GM efficace si elle produit la même voiture avec moins d’employés (à cause de licenciements) et avec moins de coûts environnementaux (en polluant plus la rivière avoisinante), car elle ferait alors plus de profit. Il ne s’agit alors pas d’efficacité, mais de rentabilité financière destructrice.
Réalité et illusion
Le capitalisme joue sur deux tableaux : l’économie réelle et l’économie financière. On peut facilement définir l’économie réelle comme celle qui a trait aux utilités : arbres, poissons, nourriture, vêtements, immeubles, etc. Ces utilités tangibles ne peuvent croître à l’infini, dont ne peuvent en elles-mêmes générer des profits infinis.
Pour faire encore plus d’argent, il faut créer une économie virtuelle : l’économie financière. Elle est constituée de tout ce qui n’est pas d’utilité directe, soit la bourse, les banques, le Fonds monétaire international, etc. Elle utilise l’ordinateur dont la tâche est de maximiser le cash-flow. En quelques nanosecondes dans un contexte boursier, il peut vous faire gagner ou perdre de milliards de dollars. C’est ainsi que s’amassent les nouvelles fortunes.
Le rêve américain
Aux États-Unis, un pour cent des Américains accaparent 75 % de la richesse du pays. Et la classe moyenne y est surendettée au rythme de 260 %, si on inclut tout avoir à crédit. Elle ne peut dépenser beaucoup plus. Alors, où peut-on encore faire de l’argent ?
Chez les plus pauvres, avance Aktouf. On leur offre de belles et grandes maisons, bien au-dessus de leurs moyens. Rien à payer avant deux ans, des taux d’intérêt minuscules, une période de remboursement de cinquante ans. La valeur de leur maison continuera de s’accroître d’année en année. Une deuxième hypothèque paiera les mensualités de la première. Somme toute, une superbe maison gratuite, ou presque !
Beaucoup ont été séduits par la réalisation immédiate d’un rêve qu’ils ne croyaient plus possible. Et ils ont signé le contrat d’hypothèque qui ne les obligeait à presque rien, du moins pendant les premières années. Une grande inventivité financière s’ensuivit et elle fit en sorte que ces hypothèques furent vendues et revendues en bloc de milliards de dollars avec la promesse d’un haut rendement. La Caisse de dépôt et de placements du Québec en a elle-même acheté pour 13 milliards de dollars.
Tout allait pour le mieux : les revendeurs percevaient une honorable commission sur chaque vente, les acheteurs croyaient en la promesse d’un haut rendement, basée plus sur la réputation des institutions financières qui les transigeaient que sur la valeur réelle des actifs. Ces papiers commerciaux adossés à des actifs n’étaient-ils pas aussi assurés ? Si le rendement était inférieur, l’assureur le comblait, sinon il gardait le surplus du rendement. Et l’un assurait l’autre, tout en percevant une rétribution pour son risque additionnel.
Cette frénésie de transactions tirait son énergie d’un rêve typiquement américain. Celui de posséder sa maison sans y mettre le prix et celui de faire, sans trop d’efforts, beaucoup d’argent avec des titres. On a voulu oublier que ces titres étaient surévalués et très risqués, car ils étaient adossés à des hypothèques trop lourdes pour leurs acquéreurs. La période gratuite passée, les nouveaux propriétaires de maison n’ont pu rencontrer leurs mensualités et ont fait défaut en masse. Cela a diminué substantiellement la valeur de leur maison, puisqu’il y en avait alors trop à vendre sur le marché. Les banques ont accusé des pertes qui ont fait chuter la valeur de titres super gonflés à presque rien. Une crise financière (et économique) mondiale s’ensuivit.
Mesures inadéquates
Le gouvernement américain, de concert avec les autres gouvernements nationaux, a réagi pour tenter de stopper la crise financière. Une première mesure consiste à surveiller étroitement le capital. Elle ne constitue malheureusement qu’une déclaration d’intention puisqu’aucune action concrète n’est ni précisée ni prévue pour accentuer cette surveillance. Cette mesure sera rapidement reléguée aux oubliettes.
Deuxièmement, on réitère sa volonté de mieux contrer l’évasion fiscale. On dresse une liste des paradis fiscaux, classés selon les pays qui refusent catégoriquement toute ouverture bancaire, ceux qui le feront sous conditions et, finalement, ceux qui ouvriront leurs comptes sans condition (pas totalement vrai, en pratique). Mais, s’indigne le conférencier, on ne mentionne pas les deux paradis fiscaux les plus importants : les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ces deux états possèdent des paradis fiscaux par dizaines sur des îles territoriales qui leur appartiennent (Bermudes, Bahamas, Îles Caïman, Îles Vierges...). Sur le territoire même de ces deux états, on retrouve nombre d’institutions qui recyclent de l’argent « sale », dans des villes comme Las Vegas et Miami. Et tout cet argent se retrouve finalement « propre » dans des banques. L’évasion fiscale a encore de beaux jours devant elle — une mesure pour la contrer sans dents, qui ne changera rien.
Une troisième mesure prévoit mille milliards de dollars aux pays rendus encore plus pauvres par la crise financière et économique. C’est minuscule à comparer aux dix mille milliards de dollars données aux banques ! Sans compter qu’il n’y a aucune garantie que cet argent sera effectivement versé et qu’il profitera à ceux qui en ont le plus besoin dans ces pays. N’oublions pas non plus que dix mille milliards de dollars correspondent à ce qu’on estime être l’évasion fiscale annuellement sur la planète, ajoute le conférencier. Une mesure manifestement insuffisante pour aider les trois quarts du globe.
La majeure partie de l’argent donné (dix mille milliards) pour aider à résorber la crise est allée aux institutions financières. Ce cadeau leur permettra sans doute de déclarer bientôt des profits. Ce sont elles qui sont à la source du problème... et on les aide pour qu’elles puissent poursuivre le même genre de transactions qui ont précipité la crise. La plus grande partie de l’argent aurait dû aller aux industries et aux travailleurs qui font tourner l’économie réelle. Faute de quoi, le chômage va se poursuivre et une autre bulle, probablement encore plus dévastatrice que la première, prédit Aktouf, éclatera d’ici quelques années.
Solutions tenables
Les vraies solutions ne passent pas par le secteur financier, mais par une meilleure gestion du secteur industriel. On doit réformer le capitalisme industriel, comme l’ont fait des pays comme l’Allemagne et certains pays scandinaves. Cette réforme a enchâssé dans la constitution de ces pays les principes de cogestion des entreprises : toute firme de cinq employés et plus doit obtenir l’accord de ses employés pour prendre une décision qui affecte l’entreprise.
Salaire et dividendes appartiennent aux particuliers qui y ont droit, mais tout surplus appartient à l’entreprise gérée par tous les employés ; ces derniers pourront décider de consacrer ces surplus à l’amélioration des machines ou à la formation des employés. Les entreprises gérées de cette façon font appel à l’initiative et l’inventivité des employés pour améliorer les procédures de travail et prospèrent de façon phénoménale, comme on peut le constater en Allemagne et au Japon.
Cette façon de gérer l’entreprise procure des avantages compétitifs énormes, car elle mise d’abord sur l’intelligence et la formation de ses employés. Une population plus instruite travaille de façon plus efficace. Même en payant des salaires doubles de ceux de la France, l’Allemagne a deux fois plus de surplus commerciaux que la valeur du déficit commercial de la France. Le système de cogestion des entreprises explique la différence. Les exemples du succès de la cogestion existent, mais nos dirigeants ne veulent pas les voir parce que cela ne leur convient pas ; ils préfèrent conserver leurs privilèges de patrons autocratiques et s’approprier la grosse part du gâteau.
Le Consensus de Pékin promeut un type de gestion semblable, soutenue par une forte intervention de l’État dans l’économie. Il inclut le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. D’abord, il recherche le développement autocentré, soit la satisfaction première du peuple producteur, dont l’élément principal est l’éducation. Ensuite, il vise l’autosuffisance selon le modèle de distribution de la richesse au peuple, proportionnellement à l’enrichissement de l’entreprise et de ses dirigeants. De plus, la mesure des progrès ne s’évaluera plus sur la base du produit intérieur brut, mais au travers d’indicateurs qui incluront la pauvreté, la santé, l’éducation, le transport, les services publics et l’écologie, entre autres.
Conclusion
En Amérique, on n’a plus que quelques années pour changer radicalement de paradigme de production. On doit voir l’économie différemment. Et, pourquoi pas ? Suivre l’exemple de pays industrialisés vraiment prospères comme l’Allemagne et le Japon. Malheureusement, nos dirigeants n’y semblent guère enclins. Pourtant, sans ces changements majeurs, on peut s’attendre à plus de chômage, à des crises financières successives et à un influx croissant de réfugiés, chassés de leurs pays par les conséquences du réchauffement climatique.
Il faut cesser de ne penser qu’en termes de coûts. La santé, l’éducation et les services publics sont plus que cela. Considérons-les plutôt comme des investissements qui nous rendront plus productifs. Le capitalisme financier, mû par la cupidité, ne sert que l’enrichissement outrancier d’une infime minorité aux dépens de la majorité. Nous ne sortirons de la crise que si nous investissons massivement dans le bien-être, l’éducation et la dignité de notre population, conclut Omar Aktouf.
Période de questions
Science économique
Question : L’économie est-elle une science ? Certains économistes l’affirment haut et fort, sans tenir compte des idéologies politiques qui généralement sous-tendent les principales thèses économiques.
Réponse : Vous avez parfaitement raison, acquiesce Omar Aktouf. L’économie est farcie d’idéologies. Et, il existe des dizaines d’économies distinctes : marxisme, néo-marxisme, keynésianisme, néo- keynésianisme, post-keynésianisme, monétarisme, etc. Rappelons qu’un récent prix Nobel en économie a honoré conjointement deux économistes qui soutiennent des thèses diamétralement opposées !
Les précurseurs classiques (Smith, Malthus, Ricardo, Mill et Marx) ne séparaient pas l’économie du reste de la vie citoyenne (politique, religion, agriculture...). Toutefois, leurs successeurs ont voulu faire de l’économie une science exacte semblable à la physique ; ils l’ont mathématisée à outrance et ils ont emprunté abusivement le vocabulaire scientifique (forces du marché, masse monétaire, élasticité de la demande, etc.).
Ces changements ont suivi l’évolution de la classe dominante formée au début du « gentleman-farmer » vers l’avènement du magnat industriel soutenu par une armée de comptables. L’économie dite « scientifique » suivrait des lois aveugles (comme la physique) et n’aurait pas à expliquer les inégalités, la pauvreté et le chômage.
La monnaie commune
Question : Que se passerait-il si l’améro devenait monnaie commune des États-Unis, du Mexique et du Canada ?
Réponse : Cette question peut s’examiner de plusieurs façons, nuance le conférencier. Le Canada a profité pendant cinquante ans d’un dollar faible par rapport à celui des États-Unis, qui sont devenus son marché de prédilection au rythme de représenter jusqu’à 90 % de ses exportations. Le consommateur américain, en grande partie inculte, recherche d’abord le bas prix, bien avant la qualité.
Puisque le dollar canadien se retrouve maintenant au par avec la devise américaine, quels pays achèteront les produits canadiens ? Les autres pays industrialisés, tels le Japon, l’Allemagne et la Scandinavie, n’achètent pas de produits canadiens qui sont, en général, de qualité inférieure. Comment pénétrer ces marchés qui recherchent des produits plus sophistiqués que ce nous vendions aux Américains ? De plus, personne n’a intérêt à ce que le dollar américain chute dramatiquement puisque beaucoup de monnaies nationales y sont rattachées et parce qu’alors les produits américains moins chers envahiraient le marché mondial.
L’améro représente aussi une chimère à court terme. Les économies des trois pays de l’Amérique du Nord devront d’abord uniformiser leurs économies avant que cela ne devienne possible. Ce processus a pris des dizaines d’années en Europe avant que l’euro devienne la monnaie de la communauté européenne. Cette homogénéisation industrielle, infrastructurelle et sociale devrait prendre autant de temps en Amérique. La seule voie rapide pourrait signifier que le Canada devienne le 51e état américain – ce qu’il faut à tout prix éviter, termine le conférencier !