Conférence du vendredi 13 juin 2008 - 19 heures
Science et croyances
Les leçons de l’homme de Kennewick
Yves Gingras, UQÀM
Y a-t-il opposition fondamentale entre science et croyances religieuses ? Ne peut-on trouver un terrain d’entente entre ces deux visions du monde que certains considèrent indépendantes et même complémentaires ? Yves Gingras, professeur au département d’histoire à l’Université du Québec à Montréal, a répondu clairement à ces questions dérangeantes dans une allocution qu’il a prononcée chez les Sceptiques du Québec le 13 juin 2008 : il faut choisir son camp et vivre avec les conséquences de son choix.
Texte annonçant la soirée
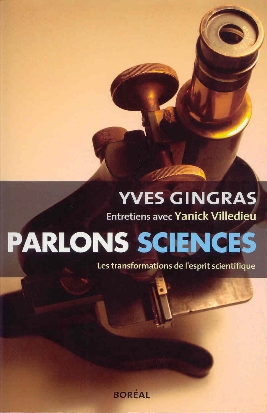
L'activité scientifique repose sur certains fondements métaphysiques et épistémologiques. La saga de la découverte de l'Homme de Kennewick en 1996 permet de mettre en évidence de façon concrète les effets de ces choix philosophiques sur la possibilité de faire de l'anthropologie. Face à des restes humains, on peut en effet choisir de les objectiver et de les analyser ou de les considérer comme « sacrés » et de les entourer de rituels avant de les retourner à la terre.
L'objectif de notre présentation sera de faire ressortir les principales caractéristiques qui opposent la science aux croyances religieuses.
Yves Gingras est professeur au département d’histoire de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM). Chercheur prolifique, il est aussi un communicateur reconnu que le public a le plaisir d’entendre régulièrement à la radio de la Société Radio-Canada à l’émission Les Années lumière, où il tient une chronique depuis 1997. En 2005, il a mérité le Prix Gérard-Parizeau « en reconnaissance de son œuvre exceptionnelle et de son engagement social dans l’ouverture du vaste et difficile champ de l’histoire des sciences ». Il vient de publier « Parlons sciences, les transformations de l’esprit scientifique » aux éditions Boréal.
Science et croyances
Les leçons de l’homme de Kennewick
Yves Gingras, UQÀM

Pourquoi parler de l’homme de Kennewick en relation avec la science et les croyances, lance Gingras ? Il est vrai que ce cas a été beaucoup discuté aux États-Unis à la fin des années 1990 : il s’agit de la découverte d’ossements vieux de 9 000 ans que les autochtones veulent enterrer selon leurs rites ancestraux avant que les scientifiques ne puissent les examiner en détail. Malgré les vifs débats pour justifier de part et d’autre un droit au squelette millénaire, qui fit même l’objet de plusieurs jugements, tous favorables aux scientifiques, de la Cour de l'État de Washington, il ne semble pas qu’on ait encore tiré la leçon fondamentale de cet épisode récent des rapports entre la science et les croyances religieuses.
Rappelons d’abord que le sociologue des sciences étudie les comportements humains vis-à-vis les sciences sans porter de jugement moral, tout comme le ferait l’éthologue qui étudie les fourmis. Si certaines fourmis rouges tuent ou réduisent en esclavage des fourmis noires (ou l’inverse !), l’éthologue tente d’expliquer ce comportement en testant différentes hypothèses. Il ne lui vient pas à l’idée de porter un jugement moral sur la cruauté des fourmis rouges envers les noires. Il cherche à expliquer, non pas à juger.
Pour porter un jugement, le sociologue des sciences, comme tout citoyen, peut toutefois adopter une éthique conséquentialiste : si des agents sociaux adoptent une certaine vision du monde, ils doivent alors en accepter toutes les conséquences ou encore changer cette croyance s’ils jugent que les conséquences qui en découlent ne sont pas acceptables.
Un long processus de décentrement
Avant de poursuivre, notons ceci : l’histoire des sciences met en évidence une caractéristique fondamentale de la pensée scientifique : le décentrement progressif de notre conception du monde (Gingras développe cette idée plus à fond dans son essai « Éloge de l’Homo technologicus »).
Nous nous pensions au départ au centre de l’univers : les planètes, le Soleil et les étoiles tournaient autour de la Terre et donc de nous. Copernic démontra au milieu du 16e siècle que c’était, au contraire, la Terre qui tournait autour du Soleil, nous reléguant ainsi à une planète comme les autres, tournant toutes autour du Soleil. Nous savons maintenant que le Soleil est une petite étoile, parmi des milliards d’autres, située quelque part dans la galaxie et que l’univers est formé de milliards de galaxies sans centre réel.
Après avoir perdu notre place centrale dans l’univers physique, nous avons pu nous consoler quelque temps en croyant que nous étions tout de même le centre du monde vivant sur la Terre. Mais, pas bien longtemps, car un deuxième décentrement fondamental s’imposa au milieu du 19e siècle. Le naturaliste anglais Charles Darwin démontra que notre présence parmi les êtres vivants résulte de hasards et de contingences suivant la loi de l’évolution des espèces par sélection naturelle – comme c’est le cas pour toutes les espèces vivantes présentes et passées.
Au début du 20e siècle survint un troisième décentrement qui nous fit perdre notre place privilégiée d’être libre et rationnel conduisant sa vie par choix conscient et délibéré. Le psychanalyste autrichien Sigmund Freud avança l’idée, qui eut un impact social majeur, que nous étions surtout mus par des pulsions inconscientes que nous ne contrôlions pas. Ces quelques exemples montrent que la science progresse en rejetant tour à tour, et à tous les niveaux, la place centrale dans l’univers que les humains s’étaient spontanément accordée.
Le rôle de la science : Rendre raison par des causes naturelles
Gingras poursuit en proposant une brève définition de la science, qui se résume en deux mots : « rendre raison ». Rendre raison, c’est-à-dire expliquer ou comprendre des phénomènes naturels en faisant appel à des causes naturelles. Tous les types de phénomènes peuvent être examinés. On construira alors des modèles qui expliqueront les propriétés phénoménales des objets. Ainsi, la matière brute (liquide, solide ou gazeuse) forme l’objet de la physique et de la chimie, les cellules et les corps vivants sont les objets de la biologie, le comportement animal fait l’objet de l’éthologie, les humains sont l’objet de la psychologie et les groupes d’humains l’objet de la sociologie, etc.
La science aborde ces objets au moyen d’une méthode fondée sur l’observation et l’expérimentation. Les astronomes, par exemple, utilisent surtout l’observation ; ils ne peuvent qu’espérer l’explosion d’une étoile pour en analyser les effets, ils ne peuvent pas la provoquer. L’expérimentation, qui suppose un certain contrôle sur l’objet, n’est donc pas nécessaire à la démarche scientifique. L’éthologie est surtout une science d’observation (des animaux), où toutefois l’expérimentation pourra être utilisée pour tester certaines théories, en perturbant le système naturel, ce que l’astronomie extragalactique ne peut faire !
En rendant raison d’un phénomène, la science construit un discours cohérent qui l’explique. Ce discours prend souvent une forme mathématique, comme en physique, mais ce n’est pas essentiel. La biologie, par exemple, ne se comprend pas avec des équations mathématiques complexes, mais par des relations – non moins complexes – entre les composants des cellules (gènes, protéines, etc.). La science n’est donc pas nécessairement mathématique ou expérimentale, elle peut être seulement observationnelle.
La nature de chaque objet étudié par la science exige l’emploi d’une méthode appropriée à cet objet. On ne fait pas de la sociologie comme on fait de la physique ! Les atomes feront peu de cas d’être objectivés par une théorie physique absurde, alors que les humains s’opposeront à une théorie sociologique ou psychologique qu’ils n’aiment pas… Choisir la méthode appropriée pour examiner scientifiquement un objet spécifique équivaut à choisir, du coffre à outils du plombier par exemple, le bon outil pour le travail à accomplir.
Faire de la science, conclut Gingras, c’est donc rendre raison, en utilisant une méthode adaptée à la nature de l’objet, pour construire un discours explicatif et cohérent qui rende compte d’un phénomène particulier.
Stratégies créationnistes
Le genre de débats provoqué par l’Homme de Kennewick est en fait ancien et remonte au célèbre procès « Scopes » en 1925. Aussi appelé « procès du singe », il a opposé des fondamentalistes chrétiens, qui tenaient à une lecture littérale du récit biblique de la Création, à John Thomas Scopes, qui enseignait la théorie de l’évolution darwinienne, transgressant ainsi une loi du Tennessee interdisant un tel enseignement dans les écoles publiques. Malgré la condamnation de Scopes (à payer une modeste amende), les débats à ce sujet se poursuivront aux États-Unis jusqu’en 1987 lorsque la Cour Suprême tranchera, dans un autre procès, en faveur des évolutionnistes.
Il faut se rendre compte que les contestations des créationnistes n’arrêteront jamais, affirme Gingras. Les fondamentalistes ne lâcheront pas prise ; leur discours évoluera pour contourner les décisions judiciaires déjà rendues. Puisque le créationnisme a été jugé trop relié au discours religieux de la Bible, la stratégie suivante s’en éloignera en faisant appel à la théorie, prétendument scientifique, du « dessein intelligent ». On sait maintenant que ces efforts se sont soldés par un échec : un juge fédéral a conclu, à Dover en décembre 2005, que l’enseignement du « dessein intelligent » n’est qu’une forme nouvelle du créationnisme, doctrine incompatible avec la constitution des États-Unis, car elle viole le principe de la séparation de l’Église et de l’État.
Et ce n’est pas fini, poursuit Gingras ! La prochaine étape de la rhétorique créationniste sera probablement d’invoquer la liberté d’expression. Selon ce nouvel argument, on ne pourrait pas empêcher un citoyen, fut-il enseignant, d’aborder dans son cours de biologie la théorie du dessein intelligent, car cela violerait son droit d’exprimer son opinion, fût-elle contraire à la théorie scientifique généralement acceptée. Mais cette stratégie échouera probablement aussi, car la « liberté d’expression », évoquée à tout vent pour justifier n’importe quel discours aberrant, ne signifie pas pouvoir dire n’importe quoi, n’importe où, n’importe quand et toutes les professions sont soumises à des contraintes légitimes. À suivre donc.
Archéologie compromise
Le cas de l’Homme de Kennewick pose toutefois une question plus large que celle des rapports entre pensée scientifique et croyances religieuses : celle des limites que des croyances de toutes sortes peuvent imposer au développement de la connaissance scientifique. Depuis le début du 19e siècle, les anthropologues procèdent à des fouilles, un peu partout dans le monde, pour trouver des ossements qu’ils pourront examiner afin de mieux expliquer l’histoire de l’humanité et même tenter de dater ces restes humains par différentes méthodes. Aux États-Unis, comme ailleurs, s’est donc constituée une réserve d’ossements pour aider à mieux comprendre comment s’est effectué le peuplement des Amériques. Jusqu’en 1990, cette recherche progressait sans difficultés autres que scientifiques, alors qu’une loi, le « Native American Grave Protection and Repatriation Act » (NAGPRA), fut votée pour protéger les cimetières amérindiens découverts parfois lors de développements urbains.
La montée du religieux dans le monde influença aussi les groupes autochtones américains qui demandèrent que leur vision du monde soit également respectée. Dans leurs traditions, le respect dû aux morts demande que les restes humains soient enterrés. Si on trouve des ossements datés de plusieurs milliers d’années, il ne peut s’agir que de l’un de leurs ancêtres puisque la colonisation européenne ne date que de la « découverte » de l’Amérique en 1492. Ils revendiquent donc légalement la propriété de tous les ossements datant de la période précolombienne pour leur donner immédiatement une sépulture convenable, et surtout inviolable. De façon probablement inattendue, la loi américaine de 1990 permet non seulement aux autochtones de disposer, selon leurs rites, des restes humains identifiés comme provenant d’un des leurs, mais de le faire en quelque sorte de façon rétroactive pour les ossements que les anthropologues ont récemment datés.
Le législateur ne semble en effet pas avoir prévu que les dispositions de cette loi rendraient difficile, voire impossible, le travail de recherche des archéologues et des anthropologues. Une fois les ossements datés comme bien antérieurs à la venue des Européens, les scientifiques doivent, en vertu de la loi fédérale, les remettre aux autorités autochtones sans pouvoir les examiner plus en détail pour déterminer à quelle vague d’immigration ils appartiennent réellement. Les ossements de « Buhl Woman », par exemple, trouvés en 1989 n’ont pas tardé à être ensevelis par les autochtones en 1991 – la loi date de 1990 – sans avoir été sérieusement examinés par les scientifiques, sauf pour avoir fixé un âge probable de 10 800 ans.
Visions du monde incommensurables
Nous rencontrons ici un problème d’incommensurabilité radicale entre deux visions du monde. En science, il y a des changements de paradigmes : la physique d’Aristote ne se compare pas à la physique de Newton. Peut-on trouver une mesure commune entre ces deux types de physique ? Non, disent plusieurs philosophes, car ces deux théories sont fondées sur des visions différentes du monde qui n’ont pas de commune mesure qui permettrait de les comparer. Depuis les travaux des philosophes des sciences Paul Feyerabend et Thomas Kuhn au début des années 1960, on dit que de telles théories sont incommensurables. En fait, les sciences expérimentales permettent de faire un choix entre deux théories sur la base de l’adéquation de la théorie aux faits mesurés. Par contre, dans le domaine social, deux visions du monde incommensurables sont très difficilement réconciliables puisqu’elles impliquent des choix de mode de vie qui ne sont pas vraiment « testables » de façon objective.
En voici un exemple. Des restes humains (nommés par les chercheurs « la femme du Minnesota »), découverts en 1931, furent datés, beaucoup plus tard, d’un âge avoisinant 7 800 ans. Pendant presque 70 ans, ils ont pu être étudiés, mesurés ou comparés à d’autres sans souci d’interventions extérieures, car on ignorait son âge réel. Mais, dès qu’ils furent datés, un groupe d’autochtones les réclama pour les retourner à la terre. Leur religion affirme que de grands malheurs peuvent s’abattre sur eux si les ossements d’ancêtres ne sont pas enfouis sous terre selon les rites établis. Cette vision sociale du monde n’est pas vraiment discutable et est certainement respectable, mais elle s’oppose directement à celle de scientifiques qui veulent parvenir à une meilleure compréhension de l’histoire humaine en étudiant ces ossements de façon systématique. Ils ne purent continuer à le faire, car la loi les obligea à retourner ce squelette qui fut finalement enterré en 1999.
Voici un autre cas (celui-ci toujours sous jugement au moment de la conférence de Gingras). Trouvés en 1940 dans le fond d’une grotte du Nevada, des ossements d’un homme d’une quarantaine d’années (dénommé « Spirit Cave Man », du nom de la grotte dans lequel il a été trouvé) sont remarquablement bien conservés. Ils ont depuis été datés d’environ 9 400 ans. On a procédé à certaines reconstructions de son physique – problématiques selon Gingras, car trop sujettes à des préconceptions (les préhumains, originaires d’Afrique, sont imaginés à la peau noire, mais les premiers humains – considérés plus intelligents – sont décrits ayant la peau blanche, alors qu’aucune trace n’indique vraiment la couleur de leur peau…). Des études d’ADN qui pourraient prouver certaines affinités avec d’autres groupes ont été refusées. Des discussions pour rapatrier le squelette sont en cours. Si le jugement ordonne le retour des ossements aux Amérindiens qui les réclament, les études sur ce spécimen cesseront pour toujours, interdisant ainsi aux anthropologues de mieux connaître l’historie réelle – et non pas mythique – du peuplement des États-Unis.
Sacraliser des objets ou des lieux fait donc obstacle à la connaissance, et c’est un phénomène mondial. Dans la revue Science du 8 juin 2008, on annonce que, finalement, les tombes impériales japonaises seront accessibles à la recherche archéologique. Depuis des siècles, les sépultures des empereurs japonais, considérés comme étant des dieux vivants, étaient interdites d’accès. On les a récemment ouvertes aux chercheurs. Toutefois, la possibilité de procéder à des études archéologiques plus détaillées fait toujours l’objet de discussions avec les responsables des sites et il n’est pas certain que les chercheurs pourront y faire tous les prélèvements permettant une meilleure compréhension de l’histoire de ces sites archéologiques japonais.
Nous faisons donc face à des conflits entre des croyances incommensurables qui, en fait, ne peuvent être tranchés que par un juge. On voit ainsi que le juge, que l’on imagine seulement rendre justice en interprétant les lois existantes, agit en fait en tant qu’épistémologue et qu’il interprète aussi ce qu’est la science et ce qu’elle n’est pas. Dans le cas du procès de Dover sur le « dessein intelligent », par exemple, le juge a tranché en faveur de la science ; il a jugé que le dessein intelligent n’était pas scientifique, car il n’est pas fondé sur l’expérimentation. Tranchera-t-on en faveur de la science dans le cas des tombes impériales japonaises ? À suivre.
L’Homme de Kennewick
Mais revenons à l’homme de Kennewick. Ses ossements, trouvés par hasard en 1996 aux abords de la rivière Columbia près de Kennewick dans l’état de Washington, étaient situés sur un terrain appartenant aux Corps des Ingénieurs de l’armée américaine et sur des territoires revendiqués par une demi-douzaine de tribus amérindiennes. Au moment de la découverte de ces ossements, on avait supposé qu’ils avaient probablement appartenu à un militaire mort sur les berges de cette rivière durant la guerre de Sécession de 1860, car ils indiquaient des caractères physiques de type caucasien et non mongoloïde comme cela semble être le cas pour les tribus précolombiennes. Une datation routinière au carbone 14 qui suivit démontra qu’on se trompait complètement ! Elle établit l’âge du squelette à environ 9 400 ans. Cela rend beaucoup plus précoce qu’on le croyait la présence d’humains en Amérique, estimée la plupart du temps entre 6000 à 7000 ans. Serait-ce alors une première vague d’immigration dont les individus n’auraient pas survécu ? Question suprêmement intéressante à laquelle les scientifiques aimeraient bien pouvoir répondre !
La recherche d’une réponse à une question scientifique, note Gingras, s’apparente à un jeu qui parfois satisfait seulement la curiosité et mène parfois à des inventions utiles, comme l’éclairage électrique. Le scientifique cherche à mieux comprendre l’Univers dans un jeu dynamique de cache-cache avec la Nature. Pourquoi ? Parce que nous sommes ainsi faits, la curiosité est en quelque sorte spontanée même si elle peut s’émousser avec le temps et l’endoctrinement...
Voyons plus en détail la chronologie de cette découverte. On trouve les ossements de l’Homme de Kennewick le 28 juillet 1996. Peu après, on obtient une datation. En septembre, des tribus autochtones environnantes (Nez Percé, Umatilla, Yakama, Wannapum, Colville) réclament conjointement le squelette. Bien que la querelle fondamentale pour l’obtention des ossements oppose la pensée rationnelle et la pensée mythique, on a peu parlé des désaccords entre les tribus autochtones elles-mêmes qui réclament cet ancêtre comme l’un des leurs. Devant l’ennemi, elles se sont unies. Pourtant, leurs différends sur l’appartenance de cet homme à l’une des tribus ne pourraient se résoudre que par la méthode scientifique.
Oppositions au rapatriement
Les anthropologues de l’État de Washington se sont alors opposés au rapatriement des restes puisqu’ils perdraient ainsi un objet de recherche essentiel. Une requête devant les tribunaux pour contester l’application de la loi à ces ossements particuliers suivra un long processus où de nombreux avocats sont impliqués – qui prétendront, bien sûr, de part et d'autre, défendre une bonne cause.
En 2004, après huit ans de longues procédures qu’il est inutile de présenter ici, une Cour d’appel confirme un jugement antérieur qui avait accordé aux anthropologues le droit de faire des tests sur les ossements trouvés. Notons que les avocats du gouvernement étaient du côté des autochtones et non pas avec les anthropologues. Le Ministère de la Justice préférait que les ossements humains soient remis aux nations autochtones pour éviter des ennuis futurs. Il faut comprendre, note Gingras, que le rôle premier du gouvernement est d’assurer la bonne marche de la société et des relations entre les groupes sociaux et non pas de rechercher la vérité sur un point précis de l’histoire...
Le succès des anthropologues établit donc le précédent qu’il faut d’abord prouver, par l’ADN ou une autre méthode, la parenté des ossements avec une tribu autochtone pour que la loi sur le rapatriement s’applique. Il y avait une ambiguïté dans la loi initiale qui tenait pour acquis que tout objet ancien était par définition « autochtone ». Les politiciens, craignant qu’à l’avenir de nombreux cas de rapatriement d’ossements par des autochtones soient rejetés par la cour, proposèrent en 2005 de modifier la loi du NAGPRA de la façon suivante. Un amendement (appuyé d’ailleurs par le sénateur John McCain) ne changerait que deux mots : au lieu de définir qu’un Amérindien « est » indigène aux États-Unis, on le définirait « est ou était » indigène aux États-Unis. Ce petit détail pourrait signifier que l’Homme de Kennewick pourrait être identifié comme étant amérindien, qu’on ait ou non établi un lien de filiation avec une tribu d’aujourd’hui.
Les associations d’anthropologues sont évidemment contre cet amendement à la loi, de même que toutes les sociétés d’histoire. Elles ont donc lancé une campagne pour que l’amendement ne soit pas voté, demandant à leurs membres de protester par écrit auprès de leur Représentant au Congrès. Cela a porté fruit, car cet amendement n’a pas encore été accepté. Toutefois, le gouvernement vient de réactiver ce projet de loi et il n’est pas impossible qu’il soit finalement adopté. Encore une histoire à suivre…
Humanisme et Objectivation
Cette controverse pourra faire dire aux esprits humanistes et émotifs que les scientifiques n’ont aucun respect pour les restes humains. Ce qui est parfaitement légitime, reconnaît Gingras. En définissant un objet, la science suit un difficile mais nécessaire processus d’objectivation qui a parfois pour sujet un humain ou une pratique humaine, surtout dans des sciences comme la psychologie, la sociologie et l’anthropologie. Bien qu’en Occident, par exemple, on trouve inacceptable la scandaleuse pratique de l’excision, l’anthropologue ne pourra s’en tenir à cette réaction émotionnelle. Il voudra savoir pourquoi cette pratique s’est propagée et se poursuit encore aujourd’hui. Son travail consiste à décrire et expliquer l’origine et les pressions sociales qui en font, par exemple, dans certaines cultures, une condition au mariage.
Par certaines de ses pratiques, la culture autochtone, comme toutes les cultures, s’oppose à l’objectivation de ses croyances religieuses. Il y a incommensurabilité entre la religion qui sacralise des objets – fussent-ils humains – et la science qui vise plutôt à expliquer de façon rationnelle et qui transforme les pratiques et croyances religieuses en objet à observer et expliquer. Que ce soit des ossements dont on prélèvera des morceaux ou une relique dont on découpera des fragments pour les analyser, l’approche scientifique se veut objectivante et transforme tout en sujet possible de recherche. Ainsi, pour un scientifique dans l’exercice de son travail, le suaire de Turin représente un simple tissu sur lequel il y des marques analysables objectivement. En fait, en 1988, des scientifiques en ont prélevé une infime partie pour les dater au carbone 14. Loin d’avoir environ 2000 ans comme le supposent ceux qui croient que le suaire montre le vrai visage du Christ, les mesures suggèrent plutôt que le tissu date du Moyen-Âge et a été fabriqué vers 1350. Ce tissu ne peut donc avoir servi pour envelopper le corps du Christ. Les croyants ont bien sûr allégué qu’il y a erreur de mesure à cause d’un incendie qui l’a endommagé au 16e siècle. Mais pour tester cela, il faudrait prendre un autre prélèvement qui n’a pas été endommagé par le feu et reprendre les mesures. Cependant, les gardiens du suaire s’opposent à une telle détérioration supplémentaire de la précieuse relique…
Conséquences des croyances
Certaines coutumes ancestrales s’appuient sur des croyances religieuses qui dictent un mode de vie précis. On peut décider de les suivre à la lettre. C’est ce que font les amish, par exemple, qui rejettent toute modernité. Ils cultivent la terre sans tracteur et vivent dans une petite maison sans électricité. Leur transport s’effectue au moyen de carrioles tirées par des chevaux. Ils vivent ainsi les conséquences de leurs croyances.
Toute croyance a des répercussions sur ceux qui la partagent, comme souvent sur ceux qui la rejettent. On ne doit pas sous-estimer les conséquences inévitables qu’une cosmologie religieuse peut avoir sur la pratique scientifique. C’est particulièrement vrai depuis les années 1990. On est maintenant confronté à un choix clair : la méthode scientifique ou les croyances religieuses. Bien sûr, les deux approches ne s’opposent pas toujours et peuvent souvent s’exercer de façon parallèle, mais il est évident que lorsque les sciences remettent en cause des croyances religieuses, alors il y a un conflit entre deux conceptions du monde qui sont incommensurables.
Le désenchantement du monde
La science procède à une objectivisation de la réalité, poursuit le conférencier. Et, par le fait même, elle conduit au désenchantement du monde, comme l’a souligné le sociologue Max Weber. Le processus scientifique lui-même désacralise les phénomènes. Le tonnerre effraie par son bruit assourdissant et les éclairs meurtriers qui l’accompagnent. Si on en connaît le fonctionnement, on en a beaucoup moins peur et on sait comment s’en protéger. La science l’a ainsi démystifié et a rendu inutile le recours aux Dieux pour expliquer les grondements de tonnerre et même les tsunamis.
Certains magiciens, tel Uri Geller, se présentent comme ayant des dons paranormaux. Ils confondent même parfois des scientifiques qui spéculent alors sur des forces magnétiques ou autres habilement utilisées par le prestidigitateur. En fait, il faut souvent un magicien pour comprendre les trucs d’un autre magicien. James Randi, magicien sceptique, joue parfois ce rôle en reproduisant l’effet (par exemple, tordre une cuillère à distance), prouvant ainsi qu’il s’agit d’un truc parfaitement reproductible par un habile magicien. Il démolit parfaitement la prétention enchanteresse de Uri Geller. L’exemple des magiciens est intéressant, car il montre que quand on explique le truc, alors la magie disparaît et on se dit, un peu déçu : mais ce n’était que cela !
Certains scientifiques pourront témoigner du caractère enchanteur de leur patient travail de découverte. C’est sans doute vrai, pour ceux qui veulent mieux comprendre le fonctionnement du monde et sont tout heureux de faire une petite ou une grande découverte. Mais, du point de vue cosmologique, la science désenchante dans le sens précis qu’elle remplace le mystère par des mécanismes compréhensibles et fondés sur des lois naturelles. C’est aussi sa limite, la science ne répond pas à la question : pourquoi le monde existe-t-il ? Elle se limite à tenter de comprendre de façon naturelle comment il fonctionne.
Compromis impossible
En étudiant des squelettes trouvés aux États-Unis, les anthropologues tentent eux aussi de mieux connaître l’histoire du peuplement des Amériques. Les théories scientifiques, provenant des données empiriques étudiées, dateront les migrations successives d’Asiatiques en Amérique sur une dizaine de milliers d’années. Elles s’opposent nécessairement aux traditions orales véhiculées par les croyances ancestrales qui soutiennent que les tribus autochtones ont toujours occupé ce même territoire.
Le discours mythologique tenu par les croyants se prétend factuel. À leurs yeux, les ossements sont sacrés ; ils doivent être vénérés et mis en terre. Ces pratiques sont considérées essentielles à une vision du monde entretenue sans compromis. Seul un juge pourra décider de la poursuite ou de l’arrêt de l’étude scientifique des ossements. Un accommodement n’est pas possible si la version radicale de ces croyances est dominante.
Il y a donc opposition fondamentale entre les visions religieuse et scientifique du monde, conclut Gingras. La première enchante le monde, la deuxième le désenchante. Il existe des nuances pratiques, mais essentiellement ces pôles fondamentaux s’affrontent.
Croyances enchanteresses
Les croyances projettent une vision enchanteresse du monde : vous souffrez, demain sera meilleur ; vous allez mourir, le ciel vous attend. On adhère à ces espoirs réconfortants sans preuves – parfois malgré de nombreuses preuves contraires. Cette vision simple, et en fait magique, du monde s’appuie parfois sur de présumés miracles. Elle est clairement individuelle et personnelle ; chaque religion s’en tient à ses propres vérités, différentes de celles des autres religions.
La valeur des croyances repose sur leur stabilité et leur pérennité. Une croyance est d’autant plus établie qu’on y croit depuis plusieurs siècles, mais ses débuts ont pu être incertains et chaotiques. Ainsi, l’ouvrage « Le jour où Jésus devint Dieu » de Richard Rubenstein démontre très bien que la divinité du Christ, aujourd’hui reconnue par des centaines de millions de chrétiens, n’a été établie qu’après plusieurs conciles controversés au début du 4e siècle. De même, le récent ouvrage « Voter pour définir Dieu », de Ramsey MacMullin, montre bien comment ce sont des hommes (les Évêques) qui ont voté, souvent par de faibles majorités, pour définir la vraie foi et les attributs du Dieu chrétien, au cours de trois siècles de conciles (entre 253 et 553).
Notons, au passage, qu’en objectivant ces phénomènes religieux, ces historiens contribuent à écrire une histoire scientifique qui prend ses distances d’avec des postulats religieux et analyse vraiment ce qui s’est passé dans la réalité au lieu de tenir pour acquise l’existence de Dieu. De ce point de vue ethnographique, sensible au fait que ce sont bien les hommes qui créent les Dieux, il est bien sûr exclu d’accepter comme allant de soi les différents discours théologiques sur l’universalité de livres antinomiques (Bible et Coran) écrits il y a plus d’un millier d’années et encore moins d’admettre sans broncher qu’ils puissent guider encore aujourd’hui nos décisions éthiques, politiques et technologiques.
Science désenchantante
La science, à l’inverse, désenchante le monde, réitère Gingras. Elle explique les divers phénomènes de la nature comme l’effet de divers mécanismes plus ou moins complexes et plus ou moins mathématisés. De par leur complexité ou degré d’abstraction, les théories scientifiques s’éloignent souvent du sens commun, surtout en physique. Bien que moins abstraites et moins mathématisées, les sciences sociales comme la psychologie et la sociologie, qui concernent l’homme et la société humaine, demandent un plus grand effort de distanciation que la physique et la chimie qui traitent des particules et des molécules. En effet, les sciences humaines étudient des humains et il est plus facile de s’identifier spontanément à leurs pratiques et de dénoncer les injustices que de tenter de les comprendre, comme le ferait un éthologue étudiant les luttes entre fourmis rouges et fourmis noires.
La science vise à l’universalité. La force gravitationnelle s’applique sur Terre de la même façon que partout dans l’Univers. La science change et raffine ses théories, elle est dynamique. Elle est aussi le résultat d’un effort collectif. Si Charles Darwin n’avait pas publié sa théorie de l’évolution des espèces en 1859, Alfred Russell Wallace, qui a lui aussi découvert le même mécanisme de la sélection naturelle l’aurait fait – ou plutôt l’a fait au même moment et de façon indépendante. Sinon, un autre scientifique l’aurait fait quelques années plus tard. De plus, les acquis scientifiques servent de tremplin pour d’autres découvertes qui nous font progresser dans notre compréhension du monde. On pourra se tromper sur certains détails de l’évolution des espèces et trouver d’autres mécanismes, mais on ne reviendra pas au fixisme.
Affrontement inévitable
La religion évolue-t-elle de la même façon que la science ? Certains le prétendent en faisant remarquer que l’Église catholique admet maintenant la théorie de l’évolution. Mais, attention ! précise Gingras. Même si, en 1996, le pape a dit que la théorie de Darwin est plus qu’une hypothèse, il est loin de l’accepter dans son ensemble.
L’évolution de l’homme lui-même pose problème, car Dieu l’a doté d’une âme. Lucy a-t-elle une âme ? Le péché originel d’Adam et Ève impose aussi le monogénisme humain, selon lequel il n’y a eu qu’une sorte d’homme. Un type d’humain parallèle, descendant d’autres parents qu’Adam et Ève, n’aurait pas connu le péché originel, ce qui pose un problème théologique difficile sinon insurmontable.
Choisir son camp
Les dogmes théologiques, quels qu’ils soient, imposent certaines limites à l’évolution des croyances. Toutes les religions reposent sur des dogmes, par définition immuables, qu’elles ne pourraient d’ailleurs changer sans se dénaturer. En tant que rationaliste qui veut mieux comprendre le monde dans lequel il vit, le conférencier soutient qu’il faut choisir son camp et vivre avec les conséquences de son choix : si on choisit de croire en un certain dogme religieux, on accepte alors de laisser de côté toute recherche scientifique qui irait à son encontre. Si on choisit la science, on doit mettre de côté toute croyance religieuse qui fait obstacle à la recherche scientifique. On ne peut espérer un dialogue productif, autre que superficiel entre science et religion, car les valeurs fondamentales qui les séparent, et que le conférencier présente sous forme d’un tableau synthèse, ne peuvent que générer un dialogue de sourds.
Deux visions du monde |
||
Sciences |
Croyances |
|
Désenchantement |
Enchantement |
|
Mécanique/mathématique |
Mystique/Magique |
|
Objectif |
Subjectif |
|
Universel |
Individuel/Personnel |
|
Changeant/Dynamique |
Stable/Statique |
|
Risque |
Sécurité |
|
Progrès |
Stagnation |
|
Période de questions
Accommodement déraisonnable
Ne doit-on pas tendre vers un compromis entre les besoins de l’examen scientifique et les exigences du culte religieux ? Récemment, une momie a été retournée au groupe qui la réclamait pour des motifs religieux, mais seulement après qu’elle eût été suffisamment étudiée par les scientifiques.
On pourrait se féliciter de cet accommodement d’apparence raisonnable qui suit une tendance œcuménique populaire. Mais, est-ce une bonne solution pour l’avancement de la science, demande Gingras ? Qui sait si, dans quelques dizaines d’années, d’autres techniques, aujourd’hui inconnues, ne pourraient pas révéler d’autres secrets du même objet, précédemment hors d’atteinte ? Il aurait mieux valu le conserver disponible à la recherche scientifique.
Un tel compromis donne finalement raison à la vision religieuse du monde, aux dépens de la vision scientifique du monde. Par exemple, aujourd’hui, on peut faire des tests d’ADN sur des ossements plus facilement qu’il y a 50 ans. Les restes humains déjà retournés aux autochtones ne peuvent plus être analysés de cette façon. Et, dans le cas du suaire de Turin, les techniques de datation au carbone 14 avec accélérateur de particules demandent beaucoup moins de tissus aujourd’hui qu’auparavant. C’est d’ailleurs les quantités de tissus infimes requises qui ont fait disparaître les derniers obstacles à une datation scientifique du suaire.
Plus la science avance, plus les techniques scientifiques d’analyse se raffinent. Un scientifique sérieux voudra conserver ses artefacts le plus longtemps possible. C’est à cela que servent les musées d’histoire naturelle. Les remettre aux autorités religieuses ou aux porte-parole autoproclamés de groupes sociaux, constitue une abdication du droit de savoir face aux dogmes religieux.
Le noyau dur inaltérable
Au fil de l’histoire, les doctrines religieuses ont souvent été réinterprétées par les croyants en fonction d’enjeux politico-économiques. Elles représentent donc une rationalisation qui permet à un groupe de justifier ses ambitions et ses privilèges. Ne peut-on considérer que les croyances, elles aussi, évoluent ?
Il faut distinguer les croyances superficielles des fondements métaphysiques, précise Gingras. La science elle-même est basée sur certaines croyances structurelles, entre autres que l’univers existe indépendamment de l’humain observateur et qu’il est compréhensible. Ces a priori métaphysiques de la science, qui en constituent la condition de possibilité, s’opposent radicalement aux dogmes religieux. Par exemple, « Jésus-Christ est Dieu incarné » constitue le noyau dur d’une croyance qui ne peut changer sans dénaturer fondamentalement la religion chrétienne. C’est peine perdue de vouloir discuter rationnellement avec des croyants de thèses qui mettraient en doute des dogmes religieux, en disant qu’un être humain ne peut ressusciter et s’envoler vers le Ciel...
Bien sûr, pour des raisons stratégiques, les représentants des religions officielles modifieront leurs points de vue sur des aspects superficiels ou extérieurs à leurs croyances. Mais, en théologie, jamais le noyau dur ne changera. En science, par contre, le noyau dur pourra changer, en dernier ressort, sous la pression de faits contradictoires aux lois établies. Einstein modifia de façon fondamentale la physique newtonienne. Copernic bouleversa radicalement la cosmologie de Ptolémée, vieille de 2000 ans. Le croyant qu’était Darwin devint progressivement athée en comprenant de mieux en mieux les mécanismes évolutifs de la nature.
Peut-on sérieusement croire que l’Église catholique admettra que Dieu, qui n’intervient jamais pour empêcher le mal de dominer sur la Terre n’existe finalement pas ? Et comment se fait-il que le nombre de miracles, élevé durant le Moyen-Âge, ait chuté depuis le 17e siècle ?
Raison suffisante
Serions-nous à l’aube d’une autre décentralisation de l’humain (après celle de Copernic et de Darwin), advenant qu’on trouve de la vie sur Mars ?
Non, répond Gingras, puisqu’une telle découverte, sur Mars ou sur une autre planète, serait corollaire à l’évolution des espèces de Darwin. Selon le principe de « raison suffisante », les mêmes causes entraînant les mêmes effets, l’apparition de la vie ailleurs dans l’univers confirmerait que les principes de la biologie sont les mêmes partout. Si les conditions qui ont prévalu à l’origine de la vie sur Terre sont reproduites sur une autre planète, cette dernière devrait aussi abriter une forme de vie qui, sujette aux conditions locales, évoluera sans doute bien différemment que sur Terre – la probabilité de discussions animées avec de petits bonshommes verts nous ressemblant fortement reste infime. Mais une telle découverte serait fascinante sur le plan scientifique et pourrait en fait aider à préciser les origines mêmes de la vie, qu’il ne faut pas confondre avec la théorie de l’évolution de la vie.
On peut donc dire qu’avec la théorie de l’évolution, l’Homme a finalement rejoint la nature tout comme les autres végétaux et animaux. C’est donc la fin du processus de décentrement de soi. Tout ce qui pourrait arriver c’est que le processus s’inverse et que les humains recommencent à se prendre pour un peuple élu par un Dieu ou un peuple extraterrestre plus intelligent et plus cynique qui nous a créés pour rigoler !
Objectivité scientifique
Vous avez dressé un tableau idyllique de la science ; elle serait un jeu qui trouve objectivement des solutions aux problèmes de l’humanité. Pourtant, les hommes s’en servent pour promouvoir leurs propres intérêts, souvent divergents. La méthode elle-même qu’utilisent les scientifiques n’est connue que rétrospectivement. Des nuances importantes devraient être apportées.
La science est essentiellement un jeu, maintient Gingras. Un jeu qui suit certaines règles. Lorsqu’on joue aux échecs, on ne peut pas tout à coup décider d’appliquer les règles du jeu de dames ; on joue aux échecs ou pas. Bien sûr, il y a certains dogmes en science, mais ces postulats (pour prendre un terme plus juste) peuvent changer. Et effectivement, ils changent lorsque le dogme ne fait plus le poids face à la solidité de la preuve qui le remet en question.
On demandera des preuves extraordinaires de la rencontre présumée d’un extraterrestre au coin de la rue, mais beaucoup moins de la rencontre d’un collègue à Paris ou à Tombouctou. On sera très critique des minces preuves apportées par ceux qui ont prétendu avoir réussi la fusion froide dans leur sous-sol, alors que des centaines de scientifiques n’y sont pas encore parvenus après avoir investi des milliards de dollars dans des labos à la fine pointe de la technologie.
La science est-elle neutre ? Elle l’est dans son objectivisation du réel, atomes ou cellules souches, et n’est pas responsable de l’usage qu’on fera des connaissances objectives ainsi acquises. On ne peut attribuer à la théorie atomique le développement de la bombe atomique. La science impose son approche expérimentale à la compréhension du monde : un scientifique pourra tenter de créer la vie en laboratoire à partir de composants chimiques inanimés, un croyant ne s’y attardera pas parce que ses dogmes lui disent que la vie vient d’un souffle vital que seul Dieu peut fournir.
La science est le seul jeu qui marche pour mieux connaître le monde. L’objectivité de la science réside dans son intersubjectivité. Une thèse est d’autant plus prouvée que d’autres scientifiques arrivent indépendamment aux mêmes conclusions. Cette intersubjectivité partagée annule les biais psychologiques, inévitables au départ.
Une chose est certaine cependant : le seul postulat qui ne peut être abandonné sans cesser par le fait même de faire de la science est l’idée que la nature s’explique par des causes naturelles. Admettre par principe des causes surnaturelles, comme toutes les religions le font, c’est cesser de faire de la science. En ce sens, il y a bien un postulat invariable à la base de la science, comme il y a des règles invariables au jeu d’échec.
Le tournant
Les croyances religieuses me semblent avoir toujours fait obstacle à la recherche scientifique. Qu’on pense à Galilée, par exemple ! Que s’est-il vraiment passé en 1990 pour que vous y voyiez un moment décisif ?
Vous avez raison, l’opposition de la religion à la science n’est pas radicalement nouvelle en général, mais elle l’est spécifiquement pour les anthropologues américains qui, jusqu’à récemment, pouvaient analyser des ossements sans entraves. Depuis 1990, la loi américaine NAGPRA leur met sérieusement des bâtons dans les roues. Et cela est en partie dû à la montée récente du fondamentalisme religieux. Sans l’appui du NAGPRA, aucun juge ne donnera raison aux revendications religieuses d’enterrer des ossements millénaires. Les anthropologues doivent maintenant affronter les croyances religieuses pour pouvoir faire leur métier.
Galilée et Darwin ont fait face aux mêmes oppositions des croyants, sauf que l’Église catholique en Italie au 17e siècle avait un pouvoir politique réel. Alors qu’au 19e siècle dans une Angleterre anglicane, le pape n’avait pas le pouvoir de faire taire Darwin. Aujourd’hui, le fondamentalisme religieux tente de regagner ce pouvoir par divers moyens. Cette remontée du religieux encouragera peut-être le pape actuel à revenir sur des positions plus conservatrices sur la question de l’évolution. Cela reste à voir.
Il n’est pas surprenant que les cardinaux québécois se soient opposés au nouveau cours d’éthique et de culture religieuse. S’il est bien fait, un tel cours fera ressortir le côté historiquement humain de religions qui se sont affrontées, souvent de façon violente, pendant des siècles en Occident. Un cours d’histoire des religions, en prenant le phénomène religieux comme objet, contribuera à désenchanter le côté sublime des religions en notant, par exemple, que la divinité de Jésus-Christ n’a été formellement établie par l’Église que plusieurs siècles après sa mort. Un regard historique et anthropologique sur les religions n’a jamais été bien vu par les autorités religieuses, car un tel regard met nécessairement en évidence le caractère contingent et nullement nécessaire de la plupart des croyances religieuses et leur variation dans l’espace et le temps.
Un dialogue de sourds
Pensez-vous, comme le biologiste Richard Dawkins, que l’existence de Dieu peut être une question scientifique ?
Il est absurde, répond Gingras, de tenter de démontrer de façon scientifique que Dieu existe ou n’existe pas. Ceux qui pensent rallier leur opposant à leur thèse, d’un côté ou de l’autre, s’engagent dans un dialogue de sourds. L’athée qui affirmera qu’il n’y a pas de miracle dans la nature (que le Soleil – ou la Terre – ne peut pas s’arrêter de tourner) se fera répondre par le croyant que le Dieu tout-puissant peut briser les lois qu’il a lui-même créées. On ne peut pas contester que les objets tombent, mais on peut facilement croire que Dieu a créé la loi de la gravitation. Cela demeure une croyance qui ne change rien à la loi, sauf dans de prétendues exceptions d’une époque révolue durant laquelle un miracle non reproductible – et qui n’a laissé aucune trace – aurait eu lieu.
Dans ses débats sur l’existence de Dieu, Dawkins veut sans doute provoquer. Il doit bien se rendre compte qu’il ne convaincra jamais le véritable croyant pour qui Dieu est la réponse ultime à toutes les questions sans réponse. En ce sens, Dieu devient synonyme d’ignorance. Par contre, s’il est parfaitement inutile à l’athée de s’opposer à l’idée de Dieu, il est tout à fait souhaitable de s’opposer aux institutions religieuses qui disent tenir leur autorité de Dieu pour promouvoir des points de vue discutables, comme l’exhortation papale de ne pas utiliser le condom qui, de fait, contribue à propager le sida et autres maladies transmises sexuellement.
Un autre fait vient corroborer l’inutilité d’un soi-disant « dialogue » entre science et religion. Depuis deux siècles, le débat stagne : il n’a pas avancé d’un cran. Les croyants (théologiens et créationnistes) se servent toujours de l’argument de l’horloger de William Paley sur l’existence de Dieu, essentiellement dans sa formulation originale.
Normalement, si j’avance une hypothèse, je dois en fournir la démonstration pour qu’on me croie. Il me semble que c’est seulement parce que la croyance en Dieu est très répandue depuis longtemps que l’on peut se passer de preuve.
À l’intérieur d’un cadre scientifique, on s’attend à une démonstration rigoureuse d’une théorie avancée. Mais c’est une erreur de compter sur la même rigueur dans le domaine religieux. Les dogmes ne reposent pas sur des faits empiriques, mais sur une logique interne, souvent circulaire, sans failles pour celui qui croit.
Pensez-vous donc que la croyance religieuse forme un système complet, fermé, cohérent et inattaquable ?
En effet, affirme Gingras. On tourne en rond à discuter avec un croyant ; il demeure parfaitement logique à l’intérieur de ses croyances. Les éléments inexplicables (comme la résurrection de Jésus-Christ) sont des mystères extraordinaires. Même les contradictions de la Bible ou du Coran, telles que perçues par les incroyants, n’en sont pas aux yeux des croyants qui peuvent toujours trouver des raisons pour les expliquer.
Dire une chose et son contraire au même moment constitue une contradiction logique. Mais, le faire en deux temps différents signifie qu’on a changé d’avis ou que les circonstances ne sont pas les mêmes. À l’intérieur de son système religieux, le croyant trouvera toujours une réponse parfaitement valable à ses yeux. Si on est honnête, on doit reconnaître qu’un véritable dialogue entre science et religion est impossible, conclut Gingras. La seule position scientifique et logique est la position agnostique. Comme le disait le savant français Laplace à Napoléon : je n’ai pas besoin de l’hypothèse de Dieu pour faire de la science.